Les mensonges de l'histoire : Maximilien Robespierre
"L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. "
Napoléon Bonaparte
À
quoi bon tenter de laver l’honneur bafoué de Maximilien Robespierre? Le
sort de son souvenir n’a-t-il pas déjà été scellé par la Pensée
officielle et une historiographie partiale? N’est-il pas déjà acquis
qu’il était un dictateur sanguinaire? « Robespierriste » n’est il pas
devenu un synonyme d’extrémiste?
Quel crime infâme a-t-il commis pour être à ce point victime de la vindicte universelle?
Dans notre examen du cas Robespierre, nous nous baserons sur une simple considération des faits historiques.
Le
parcours politique de l’Incorruptible commence sous la Constituante.
Courageusement, en bon rousseauiste, il y plaide pour le suffrage
universel tandis que le reste de l’Assemblée souhaite instaurer un
suffrage censitaire où seuls les riches pourront voter : les fameux
citoyens « actifs ». Pour cet affront aux forces oligarchiques, il est
moqué par ses collègues.
«Oui les grossiers habits qui me couvrent, l’humble réduit où j’achète le droit de me retirer et vivre en paix ; le modique salaire avec lequel je nourris ma femme, mes enfants : tout cela je l’avoue, ce ne sont point des terres, des châteaux, des équipages, tout cela s’appelle rien, peut-être pour le luxe et l’opulence, mais c’est quelque chose pour l’Humanité ; c’est une propriété sacrée, aussi sacrée sans doute que les brillants domaines de la richesse. (…) Vous voulez me dépouiller de la part que je dois avoir, comme vous, dans l’administration de la chose publique, et cela pour la seule raison que vous êtes plus riches que moi !»
Maximilien Robespierre est seul. Et le suffrage sera censitaire.
Très
vite, l’orphelin d’Arras s’engage dans tous les combats. Il plaide tour
à tour la cause de la liberté de la presse, de l’abolition de la peine
de mort, de l’inviolabilité de la correspondance et du domicile, ainsi
que du refus de la loi martiale.
Robespierre
croit dur comme fer en la mission universelle et émancipatrice de la
Révolution française. Son programme politique n’est que la défense de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La Déclaration prévoit
l’égalité des hommes en droit. C’est donc naturellement que Maximilien
se prononce pour l’émancipation des juifs dans un discours qui de deux
cents ans plus tard pourfend les préjugés antisémites avec une étonnante
modernité :
« On vous a dit sur les juifs des choses infiniment exagérées et souvent contraire à l’histoire. Comment peut-on leur opposer les persécutions dont ils ont été victimes chez différents peuples ? Ce sont au contraire des crimes nationaux que nous devons expier, en leur rendant les droits imprescriptibles de l’homme dont aucune puissance humaine ne pouvait les dépouiller. On leur impute encore des vices, des préjugés, l’esprit de secte et d’intérêt les exagèrent. Mais à qui devons nous les imputer si ce n’est à nos propres injustices ? Après les avoir exclus de tous les honneurs, même les droits à l’estime publique, nous ne leur avons laissé que les objets de spéculation lucrative. Rendons-les au bonheur, à la patrie, à la vertu, en leur rendant la dignité d’hommes et de citoyens ; songeons qu’il ne peut jamais être politique, quoi qu’on puisse dire, de condamner à l’avilissement et à l’oppression une multitude d’hommes qui vivent au milieu de nous. Comment l’intérêt social pourrait-il être fondé sur la violation des principes éternels de la justice et de la raison qui sont la base de toute société humaine ? »
D’abord hésitante, l’Assemblée finit par donner l’égalité des droits aux juifs.
La
lutte de Robespierre pour la liberté et l’égalité ne s’arrête pas là.
Quand le lobby des planteurs veut faire constitutionnaliser la pratique
de l’esclavage dans les colonies par l’intermédiaire du député de
Martinique Moreau de Saint-Méry, l’Incorruptible répond à nouveau de
façon flamboyante.
« Dès le moment où, dans un de vos décrets, vous aurez prononcé le mot « esclavage », vous aurez prononcé votre propre déshonneur et le renversement de votre constitution. […] C’est grand intérêt que la conservation de vos colonies, mais cet intérêt même est relatif à votre constitution ; et l’intérêt suprême de la nation et des colonies elles-mêmes est que vous conserviez votre liberté et que vous ne renversiez pas, de vos propres mains, les bases de cette liberté. Eh ! Périssent vos colonies, si vous les conservez à ce prix. Oui, s’il fallait ou perdre vos colonies, ou perdre votre bonheur, votre gloire, votre liberté, je répéterais : périssent vos colonies.
Je
conclus de tout ceci que le plus grand malheur que l’Assemblée puisse
attirer, non pas sur les citoyens de couleur, non pas sur les colonies,
mais sur l’empire français tout entier, c’est d’adopter ce funeste
amendement proposé par M. Moreau de Saint-Méry.»
Robespierre
est encore seul. L’esclavage est permis. Mais, trois ans plus tard, en
soutenant l’abbé Grégoire, Robespierre fait de la France le premier pays
de l’histoire de l’humanité à abolir l’esclavage.
On
a accusé Robespierre de participer à la déchristianisation du pays.
Rien n’est plus faux. Il condamne toutes les exactions antichrétiennes,
terreau de l’athéisme. Afin de rendre la pratique du culte catholique
plus aisée, il se prononce même pour le mariage des curés.
Ce
qui a été fait doit être préservé. Mais les acquis révolutionnaires
sont menacés par les Girondins qui veulent militairement exporter la
Révolution. Robespierre fait connaitre son opinion : il est contre la
guerre. Ce refus ne vient pas d’un angélisme pacifiste. Il vient de la
conviction que la conquête militaire ne pourra rendre qu’insupportable
la Révolution aux peuples soumis. On connait sa phrase célèbre « Personne n’aime les missionnaires armés ».
L’orphelin d’Arras voit encore plus loin : il pressent que la guerre
n’aura pour finalité que de placer un militaire à la tête du pays.
Robespierre est toujours seul. La guerre est déclarée.
La
France se rend vite compte qu’elle doit faire face à un péril mortel.
Toute l’Europe se ligue contre elle suite à l’exécution de Louis XVI.
Pour surmonter l’épreuve, la Convention décrète la Terreur sous la
pression des classes populaires, puis proclame le Gouvernement
révolutionnaire.
La
chute des Girondins (31 mai 1793), fait rentrer l’Incorruptible au
Comité de salut public. Il s’y fixe un cap : garantir l’indivisibilité
de la République française. Il est alors convaincu que seule une France
unie pourra surmonter l’incroyable défi lancé par l’histoire. Car la
situation est catastrophique. Sur toutes les frontières, les combats
font rage entre les troupes révolutionnaires et celles d’un continent
coalisé. À l’intérieur, il faut combattre les dangers fédéralistes et
vendéens.
À
la situation militaire s’ajoute la situation économique. La monnaie ne
vaut plus rien, le circuit économique est désorganisé, la disette est
partout.
L’Incorruptible
se démène pour mobiliser les forces vives du pays. Il légitime la
Terreur par son dirigisme et ses discours enflammés. Mais qu’importe,
tous les moyens sont bons pour sauver la patrie. L’année 93 voit la
levée en masse, les réquisitions d’armes, la nationalisation des
fabriques nécessaires à la guerre et le maximum.
Tout
le pays est mobilisé. Dans la capitale, les factions sont éliminées. On
a reproché à ces exécutions à Robespierre. Pourtant, s’il est vrai
qu’il a une part de responsabilité, il ne faut pas oublier que rien
n’aurait put se faire sans l’aval de la Convention et du reste du Comité
de salut public. Imputer ces assassinats politiques au seul Robespierre
est donc une parfaite tartuferie. Par ailleurs, soyons francs.
Pouvait-on raisonnablement laisser agir les Enragés qui demandaient une
intensification de la Terreur tournant au délire génocidaire ou les
Modérés qui se prononçaient pour une soumission totale à l’ennemi ?
En
province, les représentants en mission font régner l’ordre, et ce
souvent au prix du sang d’innocents. Les têtes tombent. Mais, peu à peu,
le danger recule. L’inflation est stoppée, les ennemis sont repoussés
et les révoltes sont matées.
La
tâche accomplie est véritablement surhumaine. Il ne faut pas s’y
tromper : en ces années 1793 et 1794, la France a sauvé sa tête
(jurisprudence Pologne). Mais en se sauvant, c’est aussi l’embryon de
démocratie qu’elle était qu’elle a préservé.
Pendant
ces mois de danger, Robespierre ne se contente pas de mener la guerre.
Il supervise des réformes historiques pour le monde paysan. Un décret du
17 juillet 1793 abolit les droits féodaux qui avaient été déclarés
rachetables en 1789. Pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, les paysans sont libres, totalement libres. Ils possèdent
enfin leur terre. Ce décret est conforme à la vision robespierriste du
droit de propriété, c’est-à-dire le droit pour chacun de jouir des
fruits de son travail.
L’Incorruptible
appuie son ami Saint-Just pour le décret du 26 février 1794. En vertu
de celui-ci, les terres des nobles émigrés, déclarés ennemi de la
nation, sont redistribuées aux indigents. Même les plus humbles peuvent
acquérir de la terre. La Révolution française mène à terme le projet
millénaire des Capétiens : donner la propriété du sol aux paysans pour
rabaisser les grands.
Robespierre
a affranchi les hommes asservis, donné la terre à ceux qui n’en
possédaient pas et sauvé son pays de l’invasion, voire du démembrement.
Alors, pourquoi nous est-il présenté comme un tyran sanguinaire?
À
cause de la Terreur, en grande partie. Toute une historiographie
malhonnête a mis les excès de la Terreur sur le dos de l’Incorruptible.
Pourtant ni la création, ni les excès de la Terreur ne sont de son fait.
De surcroît, si Robespierre avait été écouté plus tôt, la Terreur
n’aurait jamais existé. Tout d’abord parce que le jeune député d’Arras
s’était prononcé pour l’abolition de la peine de mort. Puis parce qu’il
était contre la guerre, elle seule responsable de la radicalisation de
la Révolution. La Terreur a été institutionnalisé à la demande des
sans-culottes, puis appliquée avec l’aval de la Convention et du Comité
de salut public. Quant aux massacres de masse, les responsables sont les
représentants en mission.
Carrier
massacre à Nantes, Collot d’Herbois et Fouché à Lyon, Tallien à
Bordeaux, Barras et Fréron à Toulon. Les représentants en mission
agissent de leur propre chef. Ils sont les seuls responsables de leurs
exactions. Robespierre est d’ailleurs méfiant vis-à-vis de leur
personne. C’est pourquoi il envoie Jullien de Paris, député de la Drôme,
inspecter leurs actes. Le jeune député se rend vite compte que tous les
représentants outrepassent leurs prérogatives en commettant
d’innombrables crimes. De retour à Paris, il en avertit Robespierre.
Aussitôt, l’Incorruptible prend des dispositions en faisant rappeler
tous les tortionnaires (mai 1794). Mais il est depuis longtemps trop
tard : la Terreur a été déconsidérée.
Les
criminels sont Barras, Carrier, Fréron, Collot d’Herbois, Fouché et
Tallien. Or, qui sont les thermidoriens si ce ne sont Barras, Carrier,
Fréron, Collot d’Herbois, Fouché et Tallien ? Les principaux
thermidoriens sont les terroristes. C’est parce qu’ils se sentent
menacés par Robespierre qu’ils décident de se retourner contre lui. En
clair, les thermidoriens renversent Robespierre pour sauver leur tête.
Une fois l’Incorruptible déchu, ils lui font porter le fardeau de leurs
actes terroristes. Ils salissent l’image de Robespierre pour nettoyer la
leur. Imputer ses propres crimes à un innocent qui n’est plus là pour
se défendre : la manœuvre est habile, assurément. Robespierre paie
encore son adhésion à la Terreur. On a voulu convaincre l’opinion qu’il
est responsable du terrorisme. La vérité historique est pourtant là pour
nous démontrer le contraire. Robespierre a porté la Terreur et l’a
assumée. Mais les excès de cette période ne peuvent lui être imputés.
Comble
de l’ironie et du mensonge, c’est quand Robespierre se retire du Comité
de salut public, suite à une altercation avec la majorité de ses
membres, que se déchaînent les abus de la Grande Terreur… :
« Je me bornerai à dire que, depuis plus de six semaines, la nature et la force de la calomnie, l’impuissance de faire le bien et d’arrêter le mal, m’a forcé à abandonner absolument mes fonctions de membre du Comité de salut public, et je jure qu’en cela même je n’ai consulté que ma raison et ma patrie…Voilà au moins six semaines que ma dictature est expirée, et que je n’ai aucune espèce d’influence sur le gouvernement ; le patriotisme a-t-il été plus protégé ? Les factions plus timides ? La patrie plus heureuse ? »
À ceux qui en veulent à Robespierre pour la Terreur en elle-même, nous soumettons cette considération de Napoléon :
« Croyez-vous que les hommes qui ont mené la France en 93 aient choisi la Terreur pour partie de plaisir ? Non, certes ; Robespierre n’aimait pas plus le sang que je ne l’aime. Il a été entraîné par les évènements et, je le répète avec conviction, c’est par humanité, c’est pour arrêter les massacres, pour régulariser le mouvement de rancune populaire, qu’il a créé les Tribunaux révolutionnaires, comme un chirurgien qui, pour sauver le corps, coupe les membres. »
Lorsque
la Pensée officielle relaie l’image d’un Robespierre apprenti tyran,
elle ne fait que relayer la propagande thermidorienne. Peut-on décemment
traiter de dictateur un homme qui a affranchi les Juifs, les esclaves
et les paysans? Peut-on traiter de dictateur un homme qui a tout fait
pour établir le suffrage universel et qui est le premier grand
abolitionniste? Peut-on traiter de dictateur un homme qui est tombé
suite à un simple vote du parlement? Quand la Convention a commencé à
désavouer l’Incorruptible, celui-ci fut aussitôt déchu. Aucun moyen
légal ou extra-légal n’a pu le sauver de sa chute. Curieux dictateur
tout de même que celui qui vit sous le droit commun… :
« Nous voulons substituer, dans notre pays, la morale à l’égoïsme, la probité à l’honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l’empire de la raison à la tyrannie de la mode, le mépris du vice au mépris du malheur, la fierté à l’insolence, la grandeur d’âme à la vanité, l’amour de la gloire à l’amour de l’argent, les bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à l’intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à l’éclat, le charme du bonheur aux ennuis de la volupté, la grandeur de l’homme à la petitesse des grands, un peuple magnanime, puissant, heureux, à un peuple aimable, frivole et misérable, c’est-à-dire, toutes les vertus et tous les miracles de la République, à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. Nous voulons, en un mot, remplir les vœux de la nature, accomplir les destins de l’humanité, tenir les promesses de la philosophie. »
30/09/1791
L’Incorruptible
n’usurpe pas son surnom. Il mène un choix de vie individuelle unique.
Alors que quasiment tous ses collègues sont des corrompus notoires,
Robespierre vit modestement chez les menuisiers Duplay. « J’aurais
pu troquer mon âme contre l’opulence ; mais je regarde l’opulence non
seulement comme le prix du crime, mais encore comme la punition du
crime, et je veux être pauvre pour ne pas être malheureux. » La
formule est poignante. Surtout quand on sait que les paroles feront
place aux actes et qu’il ne s’agit pas ici d’une simple posture.
Tandis
que les députés se perdent dans les orgies parisiennes, Robespierre,
lui, reste vierge. Il incarne la pureté révolutionnaire jusque dans sa
chair. Voici comment Billaud-Varenne, un de ses plus terribles
adversaires, et responsable parmi d’autres de sa chute, jugeait son
attitude : « Si on me demandait comment Robespierre avait réussi à
prendre tant d’ascendant sur l’opinion publique, je répondrais que c’est
en affectant les vertus les plus austères, le dévouement le plus
absolu, les principes les plus purs.» Affecter, seulement ?
Il
fallut peu de temps au peuple pour regretter celui dont il s’était dans
un premier temps félicité de la mort. Une grande partie des réformes
sociales entreprises par Robespierre et ses amis fut stoppée net après
sa chute. Les droits sociaux de la Constitution de l’an I tombent dans
l’oubli. Le dirigisme économique disparaît. La bourgeoisie a dorénavant
les mains libres…
Caricature diabolisatrice anti-robespierre
Robespierre
commit cependant deux grandes fautes. La première fut l’instauration du
culte de l’Etre suprême. Ici, Robespierre n’a pas seulement frôlé le
ridicule, il l’a pleinement embrassé. À sa décharge, nous répondrons
qu’il est malhonnête de lui reprocher de ne pas avoir été un bon
chrétien à une époque où le clergé ne l’était pas d’avantage. Puis,
seconde faute, qui fut un crime : avoir voté mort de Louis XVI. Dans un
contexte différent, il est à parier que ces deux personnalités
historiques se seraient entendues pour faire le bonheur des Français.
Quoi
qu’il en soit, aucun patriote français ne peut oublier son sacrifice
pour le salut de la patrie. C’est pourquoi, tout Français, tout homme
libre, peut dire, comme Jaurès en son temps : je suis avec Robespierre.


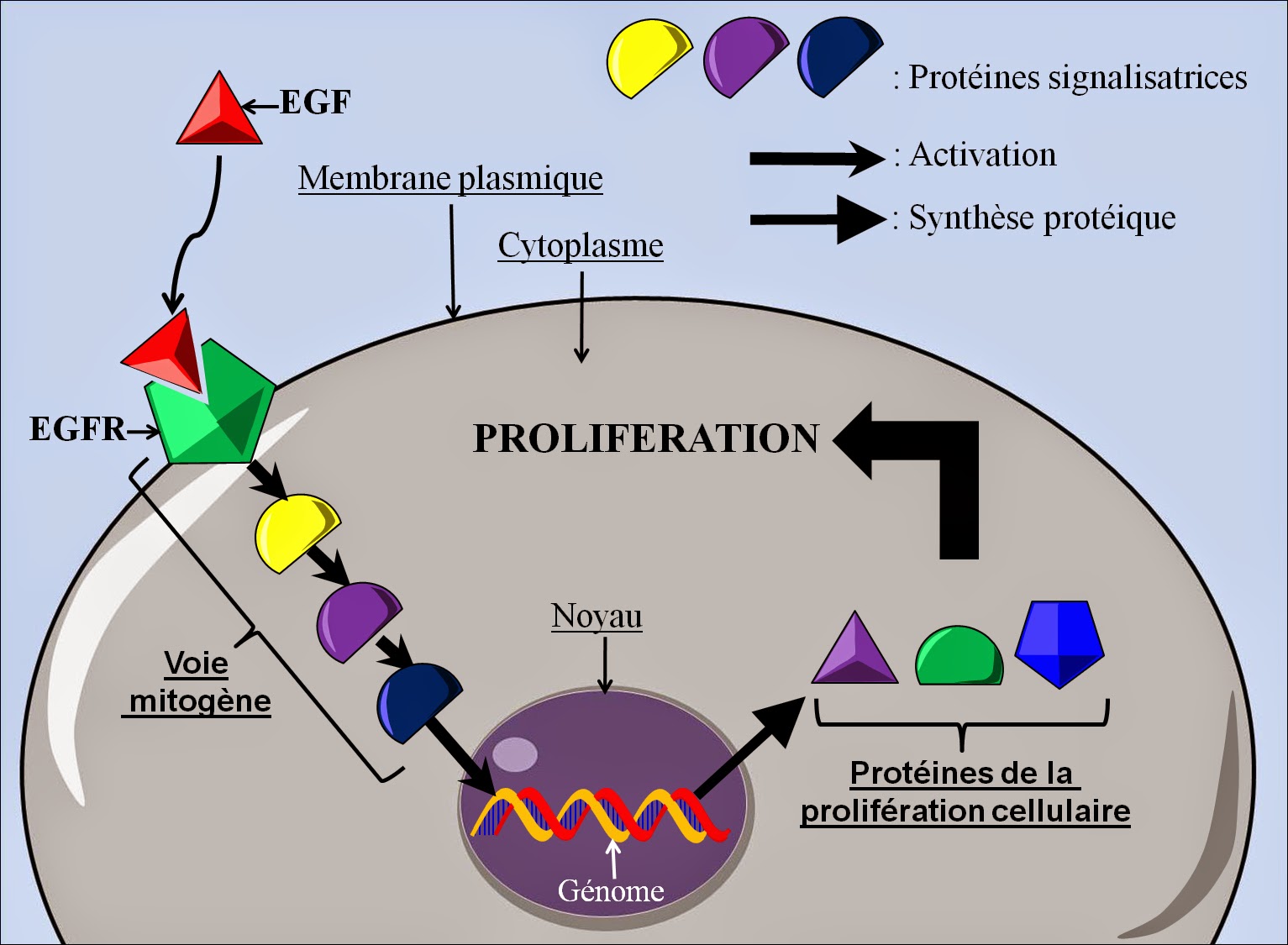
Commentaires