Fukushima : la synthèse de la catastrophe
Le
11 décembre 2012, Valéry Laramée de Tannenberg,
rédacteur en chef du Journal de l’Environnement de Paris, publiait
enfin traduite en français la Synthèse de la catastrophe de Fukushima.
Ce rapport sur la catastrophe de Fukushima montre un univers où les autorités et les exploitants d’installations nucléaires ont
privilégié leurs intérêts propres à ceux des populations.
Hasard du calendrier : un an après la nomination par le parlement de la commission d’enquête indépendante sur l’accident de
Fukushima, des traducteurs bénévoles mettent en ligne une traduction de la synthèse du rapport de ladite commission.
En quelques dizaines de pages, la synthèse du rapport dresse un tableau hallucinant non seulement de la désorganisation des
secours, passés le séisme et le tsunami du 11 mars 2011, mais surtout de la culture de sûreté nucléaire régnant au Japon.
Les auteurs le disent tout net : « L’accident nucléaire de Fukushima a été le résultat d’une collusion entre le gouvernement,
les organismes de réglementation et Tepco, et de la gestion défectueuse des dites parties ».
En introduction de leur réquisitoire, les commissaires estiment que « les causes directes de l’accident étaient toutes
prévisibles avant le 11 mars 2011 ».
«
Tepco et l’agence de sûreté nucléaire et industrielle (Nisa) étaient
conscients de la nécessité d’un renforcement structurel
pour être en conformité avec les nouvelles normes, mais plutôt que
d’exiger leur mise en œuvre, la Nisa a estimé que les mesures devaient
être prises de manière autonome par l’opérateur. »
Fustigeant
le discours officiel, les membres de la commission excluent que le
tsunami soit la seule cause des dommages de la
centrale de Fukushima : « Les dommages causés au réacteur numéro 1
ont été causés non seulement par le tsunami mais aussi par le séisme ».
Mais aussi par la conception même de la centrale
(d’origine américaine) qui ne disposait pas de « systèmes redondants
et diversifiés, ni de résilience parasismique pour les alimentations
électriques internes. Par ailleurs, le poste de
SinFukushima n’était pas résistant aux séismes. »
Les
négligences de l’exploitant du site, Tepco, sont fréquemment pointées
du doigt. Ses opérateurs ne disposaient « d’aucuns
manuels complets » et ne réalisaient pas d’exercices périodiques de
préparation aux incidents. Une fois la crise survenue, l’électricien
tokyoïte a caché des informations aux autorités et fui ses
responsabilités en ne faisant pas part au gouvernement de ses
intentions.
Faute
de leadership dans la conduite des opérations de secours, l’information
n’a pas atteint les principaux intéressés : les
habitants des zones contaminées. « Seulement 20 % des habitants de
la ville proche de l’usine étaient au courant de l’accident lorsque
l’ordre d’évacuation de la zone des trois kilomètres a été
donné. » Un ordre qui faisait suite à une consigne de «
calfeutrement prolongé au domicile », ce qui n’a pas facilité la gestion
de crise. Finalement 150 000 personnes ont été évacuées.
«
Ce qu’il faut admettre, aussi douloureux soit-il, c’est que nous avons
affaire à un désastre made in Japan. Les raisons
fondamentales sont à chercher dans le souci des convenances qui fait
partie intégrante de la culture japonaise : notre obéissance
automatique, notre réticence à remettre en cause l’autorité,
notre attachement au respect du programme, notre dépendance au
groupe et notre insularité », conclut le président de la commission.
«
Cette arrogance a été renforcée par la mentalité
collective de la bureaucratie japonaise, pour laquelle le premier
devoir de tout bureaucrate est de défendre les intérêts de son
organisation. Poussée à l’extrême, cette mentalité a conduit à
placer les intérêts de l’organisation avant leur devoir primordial,
qui est de protéger la population », poursuit Kivoshi Kurokawa.
Constructive,
la commission formule plusieurs recommandations. D’abord, la remise à
plat du système de régulation de la sûreté
nucléaire : ce qui implique la création d’une autorité de sûreté
indépendante (notamment du puissant ministère de l’industrie), son
respect par les exploitants, la refonte du corpus juridique et
la réforme du système de gestion de crise. Les commissaires
préconisent aussi un meilleur suivi médical des populations originaires
des zones contaminées. Ils appellent enfin le gouvernement à
rendre public son programme de décontamination.
Il
y a quelques semaines, Tokiko Noguchi a reçu deux mauvaises nouvelles :
des petites tumeurs de la thyroïde sont apparues chez
son fils. Le même jour, la préfecture de Fukushima, la zone dévastée
par l'accident nucléaire de 2011 au Japon, décidait de suspendre l'aide
aux familles qui souhaitent quitter la région.
Tokiko,
qui vit avec ses proches dans cette zone, a senti le monde s'écrouler
autour d'elle. Elle avait déjà décidé de déménager
lorsque sa fille avait validé ses examens à l'école, par peur de
l'effet des radiations sur la santé de ses enfants. Elle comptait sur
l'aide au logement que les autorités donnent aux familles
sur le départ. Elle ne peut plus partir, et ses enfants continuent
d'être exposés à la contamination radioactive.
Tokiko
demande à la préfecture de Fukushima de maintenir cette aide. L'an
dernier, celle-ci avait déjà été contrainte de
maintenir certains programmes grâce à la pression des citoyens.
Aujourd'hui, Tokiko a besoin d'une grande vague de soutien pour conduire
les autorités à revoir leur décision.
Comme
Tokiko, nombre de familles à Fukushima font face à un choix terrible :
laisser leurs enfants à l'école au milieu de leurs
amis mais aussi des radiations, ou abandonner ce qui fut leur maison
pendant des décennies pour partir à l'inconnu. Les aides de la
préfecture sont le seul moyen permettant à ces familles de se
reconstruire dans un nouvel environnement.
Pour
Tokiko, il est inacceptable de voir la préfecture abandonner ces aides
moins de deux ans après la tragédie de Fukushima, en
particulier lorsque des enfants souffrent de problèmes de santé liés
à la contamination. D'autant que cette décision intervient en décembre
alors que de nombreuses familles attendaient la fin des
cours en mars prochain pour partir.
Tout cela devrait servir de leçons à tous ceux qui prônent encore le nucléaire et sa sécurité car en France, comme toujours,
nous ne risquons RIEN

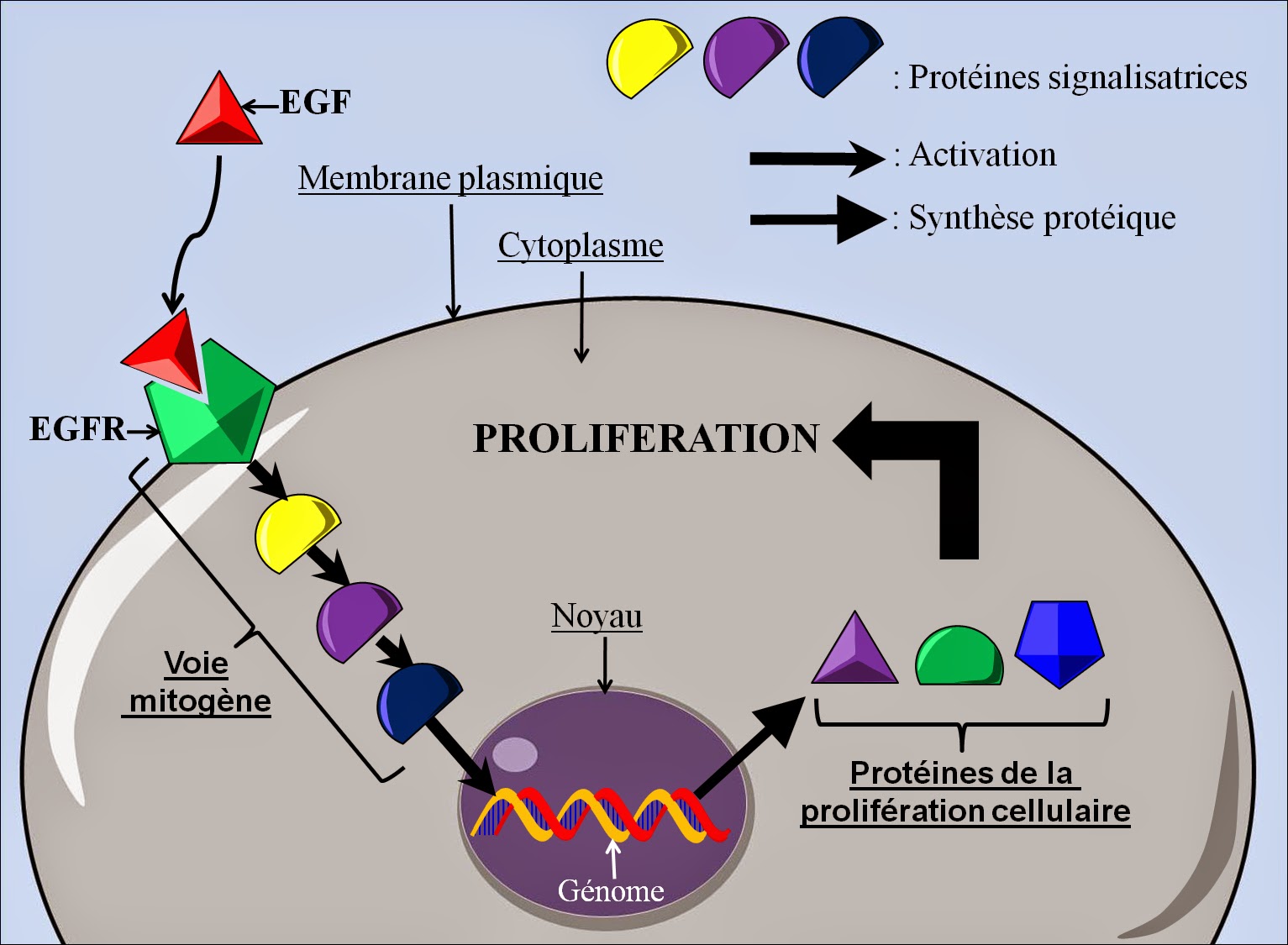
Commentaires